
Publié le 15 juillet 2025
L’idée reçue a la vie dure : pour beaucoup, la voie royale vers les Grandes Écoles reste la classe préparatoire. Les admissions parallèles seraient, au mieux, une seconde chance, au pire, une voie de garage. C’est une erreur de perspective fondamentale. Loin d’être un plan B, l’admission sur titre est la voie de l’excellence pour des profils différents, plus matures, et qui ont déjà une expertise concrète. Vous êtes en BUT, en BTS, en Licence ou en Master ? Vous n’êtes pas un candidat « alternatif », vous êtes un candidat avec une histoire, des compétences tangibles et une vision du monde professionnel souvent bien plus affinée que celle de vos concurrents sortant de prépa.
Votre défi n’est pas de combler un prétendu « retard », mais d’apprendre à raconter votre parcours. Il ne s’agit pas de lister des expériences, mais de construire un récit cohérent et puissant qui démontre au jury non pas seulement ce que vous savez, mais ce que vous avez fait, et surtout, pourquoi vous l’avez fait. De la gestion de projet concrète en DUT aux compétences techniques pointues acquises en BTS, chaque étape de votre cursus est un chapitre de cette histoire. Le monde des concours, qu’il s’agisse de tests d’aptitude comme le TAGE MAGE ou d’épreuves orales, n’est pas conçu pour vous piéger, mais pour identifier les profils capables de transformer une expérience en potentiel. Cet article est conçu comme une session de coaching stratégique pour vous aider à devenir le narrateur de votre propre succès.
code
Code
download
content_copy
expand_less
Pour ceux qui préfèrent un format condensé, cette vidéo résume l’essentiel des points abordés dans notre guide et présente en détail le concours ACCES, une des portes d’entrées possibles. Une présentation complète pour aller droit au but.
Cet article est structuré pour vous guider pas à pas dans la construction de votre candidature. Voici les points clés que nous allons explorer en détail pour faire de votre parcours votre meilleur argument :
Sommaire : Révéler la force de votre parcours en admission parallèle
- L’avantage caché de votre DUT que les préparationnaires n’ont pas (et comment le valoriser)
- Pourquoi le TAGE MAGE est avant tout un test de votre vision stratégique
- Concours Passerelle, Tremplin ou dédiés : comment choisir votre porte d’entrée stratégique ?
- La lettre de motivation percutante : déjouer l’erreur commise par 90% des candidats
- Comment faire de votre parcours « hors-norme » le point fort de votre entretien oral ?
- Le plan d’action pour intégrer une grande école d’ingénieurs après un BUT ou un BTS
- Décoder la césure : comment la présenter comme une expérience stratégique sur votre CV
- L’art du storytelling : unifier votre parcours pour convaincre, même avec des détours
L’avantage caché de votre DUT que les préparationnaires n’ont pas (et comment le valoriser)
La première étape pour construire un récit puissant est de déconstruire un mythe : celui de l’infériorité académique des parcours professionnalisants face aux classes préparatoires. La réalité est que vous possédez une richesse que les élèves de prépa effleurent à peine : l’expérience concrète. Un DUT ou un BTS ne vous a pas seulement appris des théories, il vous a plongé dans la gestion de projet, le travail en équipe sur des cas réels, et la résolution de problèmes pratiques. C’est votre atout maître. Le jury ne cherche pas un clone de préparationnaire ; il cherche une personnalité complémentaire, capable d’apporter une perspective différente à une promotion.
Votre mission n’est pas de vous excuser de ne pas avoir fait de prépa, mais de revendiquer fièrement ce que votre parcours vous a apporté. Structurez votre discours autour de la méthode « Problème-Action-Résultat ». Au lieu de dire « j’ai fait un stage en entreprise », racontez : « Face à [problème concret rencontré], j’ai mis en place [action spécifique que vous avez menée], ce qui a permis d’obtenir [résultat quantifiable] ». Cette approche transforme une simple ligne sur un CV en une démonstration de compétence. D’ailleurs, les chiffres montrent que cette voie est loin d’être anecdotique, puisqu’environ 11% des admis en école d’ingénieurs en première année proviennent de parcours BTS ou DUT.
Comme le souligne un Expert en pédagogie universitaire dans une analyse pour Concours ACCES – Admissions parallèles :
Le parcours en DUT apporte une maîtrise pratique et concrète que les classes préparatoires ne développent pas toujours, ce qui est un véritable atout face au jury.
Le jury sait que vous n’avez pas le même bagage théorique en mathématiques pures, et ce n’est pas ce qu’il évalue. Il veut voir votre capacité d’adaptation, votre maturité et votre compréhension des enjeux professionnels. Chaque projet tutoré, chaque stage, chaque mission est une preuve que vous êtes déjà un professionnel en devenir. C’est cette histoire, celle d’un praticien réfléchi, que vous devez mettre en scène.
Pourquoi le TAGE MAGE est avant tout un test de votre vision stratégique
Beaucoup de candidats abordent le TAGE MAGE comme un simple examen de connaissances, une sorte de baccalauréat accéléré. C’est une erreur stratégique majeure. Le TAGE MAGE n’est pas conçu pour tester votre savoir encyclopédique, mais votre agilité intellectuelle et votre capacité à prendre des décisions sous pression. Il s’agit moins de « savoir » que de « savoir-faire » : savoir gérer son temps, savoir identifier les questions rentables, savoir quand passer une question plutôt que de s’obstiner. En somme, c’est un test de stratégie pure.
La structure même du test, avec ses 90 questions réparties en 6 épreuves pour une durée totale 2 heures, est pensée pour évaluer votre endurance et votre lucidité. Le candidat qui réussit n’est pas forcément celui qui a le plus de connaissances en mathématiques, mais celui qui a le meilleur plan de match. Il aborde chaque sous-test comme un sprint, en sécurisant d’abord les points faciles et en ne s’attaquant aux questions complexes que si le temps le permet. C’est une mentalité de gestionnaire, pas d’universitaire.
Pour développer cette approche stratégique, il est essentiel de comprendre que la préparation ne se limite pas à faire des exercices. Elle doit simuler les conditions réelles de l’épreuve pour développer les bons réflexes et la gestion du stress.

Comme le montre cette image, le TAGE MAGE requiert une boussole interne, une direction claire. Votre préparation doit être guidée par une méthode rigoureuse, et non par une accumulation désordonnée de connaissances. C’est en vous entraînant à penser comme un stratège que vous ferez la différence le jour J, transformant cette épreuve en une démonstration de votre potentiel managérial.
Conseils pour préparer efficacement le TAGE MAGE
- Étape 1 : Se familiariser avec le format du test via des tests blancs.
- Étape 2 : Identifier ses points faibles et travailler les sous-tests correspondants.
- Étape 3 : Chronométrer ses séances pour améliorer rapidité et stratégie.
- Étape 4 : Prendre des pauses régulières pour maintenir la concentration.
- Étape 5 : Faire des bilans hebdomadaires des progrès réalisés.
Concours Passerelle, Tremplin ou dédiés : comment choisir votre porte d’entrée stratégique ?
Le paysage des admissions parallèles peut sembler complexe avec ses multiples portes d’entrée : concours communs comme Passerelle et Tremplin, ou concours propres à certaines écoles. Choisir la bonne voie n’est pas une question de prestige, mais d’alignement stratégique entre votre profil, votre projet professionnel et les spécificités des écoles visées. Chaque concours a sa propre philosophie, ses propres épreuves et cible des profils légèrement différents.
Les concours communs comme Passerelle et Tremplin sont des banques d’épreuves qui mutualisent les tests écrits pour un ensemble d’écoles de commerce. L’avantage est évident : avec une seule série d’épreuves, vous candidatez à plusieurs établissements, optimisant ainsi votre temps et votre énergie. Tremplin, par exemple, ouvre les portes d’écoles comme KEDGE ou NEOMA, tandis que Passerelle couvre un autre spectre d’établissements reconnus. La différence se joue souvent sur les épreuves orales, qui restent spécifiques à chaque école, et sur les coefficients accordés aux différentes matières, ce qui peut avantager certains profils par rapport à d’autres.
À côté de ces grandes banques d’épreuves, de nombreuses écoles, notamment les plus prestigieuses ou celles ayant des positionnements très spécifiques (comme les écoles d’ingénieurs), organisent leurs propres concours. Cette option est pertinente si vous avez un projet très ciblé et que vous souhaitez concentrer tous vos efforts sur un ou deux établissements qui correspondent parfaitement à votre plan de carrière. La préparation est alors plus intensive et spécifique, mais le jeu peut en valoir la chandelle si l’école de vos rêves n’est pas dans une banque commune.
La clé est donc une analyse en amont. Ne choisissez pas un concours par défaut. Listez les écoles qui vous intéressent, étudiez en détail leur programme, leurs valeurs, et les profils de leurs diplômés. Ensuite seulement, identifiez la ou les voies d’accès correspondantes. Cette démarche proactive montrera au jury que votre candidature n’est pas le fruit du hasard, mais d’une décision mûrement réfléchie, ce qui est déjà un premier point marqué en votre faveur.
La lettre de motivation percutante : déjouer l’erreur commise par 90% des candidats
La lettre de motivation est l’épreuve où le storytelling prend tout son sens. Pourtant, la majorité des candidats tombent dans le même piège : ils rédigent une lettre générique, une sorte de CV commenté qui liste leurs expériences sans leur donner de sens. C’est l’erreur fondamentale qui rend une candidature invisible. Une lettre de motivation réussie ne parle pas seulement de vous ; elle parle de la rencontre entre vous et l’école. C’est un pont que vous construisez entre votre passé (vos expériences), votre présent (votre candidature) et votre futur (votre projet au sein de l’école et au-delà).
Comme le rappelle un Conseiller en orientation pour Objectif AST, le manque de personnalisation est rédhibitoire. Dans un article sur la préparation de la lettre de motivation, il souligne :
L’erreur la plus fréquente est de ne pas personnaliser sa lettre de motivation, rendant le texte générique et peu convaincant pour le jury.
Pour éviter cet écueil, votre lettre doit répondre à trois questions implicites que se pose le jury : Pourquoi cette école ? Pourquoi ce programme ? Et pourquoi vous ? Oubliez les phrases toutes faites sur « l’excellence académique » ou la « renommée internationale ». Soyez précis. Montrez que vous avez fait vos recherches : citez un cours spécifique, un professeur, un projet étudiant ou une valeur de l’école qui résonne particulièrement avec votre projet. C’est cette personnalisation qui prouve votre motivation réelle et sincère.
La rédaction de votre lettre est un acte de précision et de soin, où chaque mot compte pour construire votre histoire et convaincre le lecteur de votre sérieux et de votre engagement.

Votre lettre doit être une démonstration de cohérence. Chaque expérience que vous mentionnez doit servir à illustrer une compétence ou une qualité pertinente pour le programme visé. Ne vous contentez pas d’affirmer que vous êtes « motivé » ou « rigoureux » ; prouvez-le avec des exemples concrets tirés de votre parcours. C’est en montrant, et non en disant, que vous transformerez votre lettre d’un simple document administratif en un puissant outil de persuasion.
Checklist pour une lettre de motivation réussie en admission parallèle
- Étape 1 : Illustrer clairement la cohérence entre votre parcours et le projet de l’école.
- Étape 2 : Montrer votre motivation spécifique pour l’école ciblée.
- Étape 3 : Mettre en avant vos compétences transférables et expériences pertinentes.
- Étape 4 : Relire et éviter les erreurs formelles pour faire bonne impression.
Comment faire de votre parcours « hors-norme » le point fort de votre entretien oral ?
Le mot « atypique » fait souvent peur aux candidats. Il est associé à l’incohérence, au manque de direction, à l’échec. C’est une perspective totalement erronée. Pour un jury, un parcours « atypique » n’est pas un drapeau rouge, c’est une invitation à la curiosité. C’est le signe d’une personnalité qui a osé explorer, se réorienter, et qui a probablement développé une maturité et une capacité d’adaptation bien supérieures à la moyenne. Votre mission à l’oral n’est pas de vous justifier, mais de capitaliser sur cette singularité.
La clé est de transformer ce qui pourrait être perçu comme une série de détours en un cheminement logique et réfléchi. Vous devez être le scénariste de votre propre histoire. Chaque changement de cap, chaque expérience en dehors des clous doit être présentée non pas comme une errance, mais comme une étape nécessaire qui vous a permis d’acquérir une compétence unique ou de confirmer votre projet professionnel. Le fil rouge, c’est vous. C’est votre curiosité, votre résilience, votre quête de sens qui relie tous ces points.
Préparez-vous à répondre à la question « Pourquoi ce changement ? ». Votre réponse doit être positive et tournée vers l’avenir. Ne dites pas « Je n’aimais pas ma première formation », mais plutôt « Ma première formation m’a permis de comprendre que je voulais m’orienter vers [nouveau domaine], car j’y ai découvert une passion pour [compétence spécifique] ». Cette reformulation transforme un « échec » en une « prise de conscience constructive ». Le jury ne vous juge pas sur vos choix passés, mais sur votre capacité à analyser ces choix et à en tirer des leçons pour l’avenir.
Conseils pour valoriser un parcours atypique à l’oral
- Préparez un récit cohérent reliant vos expériences et choix.
- Soulignez les compétences développées hors parcours classique.
- Montrez en quoi cette atypie vous prépare mieux aux défis futurs.
- Soyez authentique et positif pour capter l’attention du jury.
Le plan d’action pour intégrer une grande école d’ingénieurs après un BUT ou un BTS
Intégrer une grande école d’ingénieurs après un parcours technologique comme un BUT ou un BTS est non seulement possible, mais c’est une voie de plus en plus valorisée par les établissements. Ces derniers recherchent des profils qui allient une solide compréhension technique à une capacité de prendre de la hauteur et de gérer des projets complexes. Votre parcours vous a déjà donné la première partie de cette équation ; l’école d’ingénieurs vous apportera la seconde. Le défi consiste à prouver au jury que vous avez le potentiel pour effectuer cette transition.
Votre dossier de candidature doit être construit comme une démonstration de ce potentiel. Mettez en avant les projets techniques les plus ambitieux que vous avez menés. Ne vous contentez pas de décrire la tâche ; expliquez la problématique scientifique ou technique que vous avez dû résoudre, la démarche que vous avez adoptée, et les outils que vous avez maîtrisés. Si possible, quantifiez vos résultats. Le jury, composé d’ingénieurs et d’enseignants-chercheurs, sera particulièrement sensible à cette rigueur scientifique et méthodologique.
De plus, montrez que vous avez déjà commencé à développer la posture d’un ingénieur. Avez-vous fait de la veille technologique dans votre domaine ? Avez-vous participé à des projets associatifs techniques (club de robotique, etc.) ? Avez-vous suivi des cours en ligne (MOOCs) pour approfondir certaines notions théoriques ? Toutes ces initiatives prouvent que votre intérêt pour les sciences de l’ingénieur dépasse le cadre strict de votre formation et que vous êtes un candidat proactif et curieux, prêt à relever les défis d’un cursus exigeant.
Étude de cas : l’intégration réussie après un BUT
Prenons l’exemple d’un étudiant en BUT Génie Mécanique et Productique. Face au jury, il n’a pas seulement listé ses compétences en CAO ou en usinage. Il a raconté comment, lors de son projet de fin d’études, il a dû optimiser une pièce pour réduire son poids de 15% tout en maintenant sa résistance. Il a expliqué sa démarche, depuis l’analyse par éléments finis jusqu’aux tests sur prototype. En faisant cela, il n’a pas parlé comme un technicien, mais comme un futur ingénieur-concepteur. Cette étude de cas illustre parfaitement comment un étudiant issu d’un BUT a réussi son admission sur dossier et entretien en transformant une expérience technique en une histoire d’ingénierie.
Décoder la césure : comment la présenter comme une expérience stratégique sur votre CV
L’année de césure est souvent perçue à tort comme une pause, une parenthèse dans les études. C’est une vision réductrice. Une césure bien menée n’est pas une année sabbatique, c’est une année d’accélération : accélération de la maturité, des compétences linguistiques, de l’expérience professionnelle ou de l’engagement personnel. Pour le jury, ce n’est pas le fait d’avoir pris une césure qui compte, mais ce que vous en avez fait et ce que vous en avez tiré. Votre travail est de transformer cette expérience en un atout tangible et différenciant.
Comme le formule un expert en recrutement, la perception de cette période dépend entièrement de la manière dont elle est présentée. Dans un article pour PMEJob sur la valorisation d’une année de césure, il affirme :
La césure est une période de croissance personnelle qui, lorsqu’elle est bien mise en avant, devient un véritable atout pour le candidat.
Ne vous contentez pas d’écrire « Année de césure en Australie » sur votre CV. Détaillez. S’il s’agissait d’un voyage, mettez en avant les compétences acquises : autonomie, gestion de budget, adaptabilité, résolution de problèmes en environnement inconnu. Si vous avez travaillé, même dans un job qui semble sans rapport avec votre projet, extrayez-en les compétences transférables : service client, travail en équipe multiculturelle, etc. Si vous avez fait du bénévolat, soulignez votre engagement et votre ouverture sur le monde.
Cette période de croissance personnelle, loin de vous ralentir, vous a enrichi et préparé différemment aux défis qui vous attendent. C’est un chapitre clé de votre histoire.
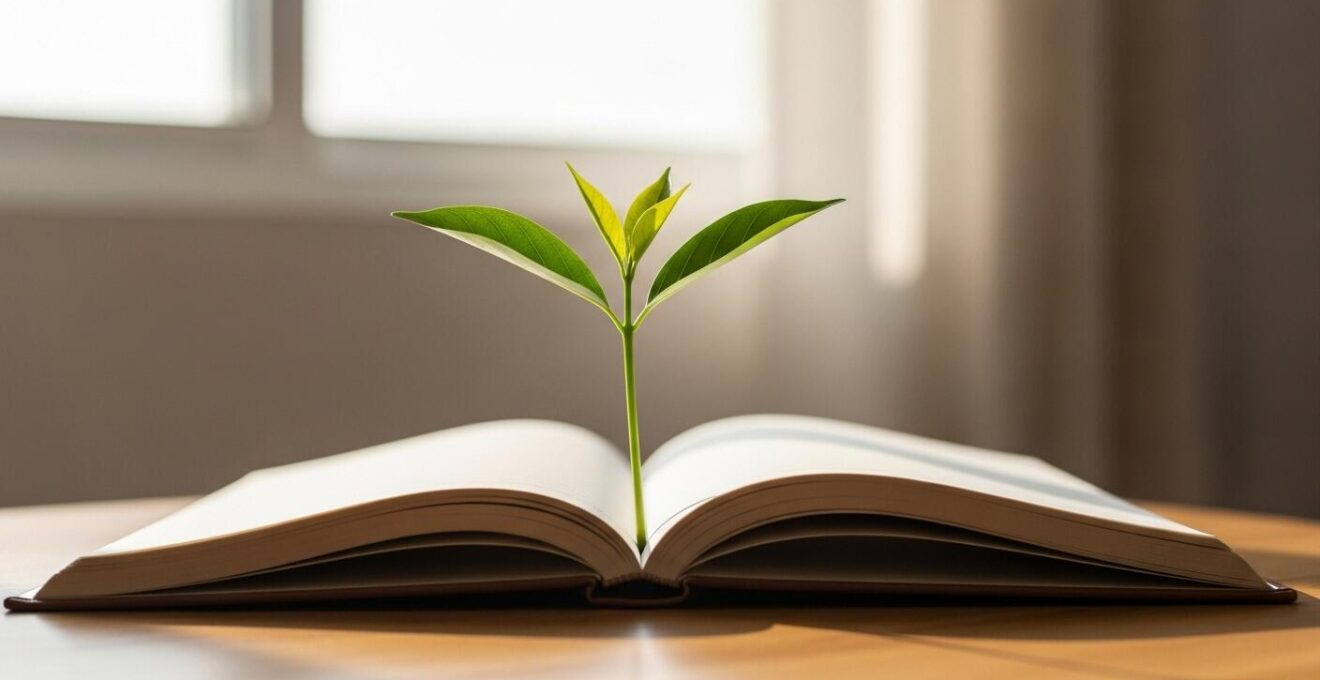
Chaque expérience, même la plus inattendue, contribue à votre développement. L’important est de savoir l’intégrer dans un récit global. Une césure réussie est celle qui trouve sa place logique dans votre parcours, non comme une interruption, mais comme un catalyseur qui a renforcé ou affiné votre projet professionnel. C’est cette cohérence narrative qui convaincra le jury.
L’art du storytelling : unifier votre parcours pour convaincre, même avec des détours
Nous arrivons au cœur de votre mission de candidat en admission parallèle : devenir le maître narrateur de votre propre parcours. Que votre cursus soit linéaire ou sinueux, la force de votre candidature ne résidera pas dans la liste de vos diplômes, mais dans votre capacité à tisser un récit cohérent et convaincant. Le jury ne recrute pas un CV, il recrute un potentiel, une personnalité, une histoire en devenir. Et c’est à vous de lui raconter cette histoire.
Comme le résume parfaitement un consultant en orientation universitaire, la clé n’est pas la perfection, mais la cohérence. Pour Admissions Parallèles – Conseils pour les candidats, il est clair que :
Ce n’est pas la linéarité du parcours qui prime, mais sa cohérence et votre capacité à en faire un récit constructif pour le jury.
Construire ce récit signifie identifier le fil rouge qui relie vos différentes expériences. Ce fil peut être une compétence que vous avez développée à travers différents contextes (par exemple, la gestion de projet), une passion qui a guidé vos choix (comme l’innovation durable), ou un objectif professionnel qui s’est affiné au fil du temps. Chaque étape, même une réorientation, doit être présentée comme une brique qui vient s’ajouter à l’édifice de votre projet. C’est ce qui transforme une succession d’événements en une trajectoire intentionnelle.
Votre histoire est votre principal argument de vente. Elle est unique, et c’est ce qui vous rend mémorable aux yeux du jury. Elle prouve non seulement que vous avez les compétences requises, mais aussi que vous possédez la maturité, la réflexivité et la détermination nécessaires pour réussir. En admission parallèle, vous n’êtes pas jugé sur le chemin que vous avez pris, mais sur la clarté de la destination que vous visez et votre capacité à expliquer comment chaque étape de ce chemin vous y a préparé.
Étapes pour rendre votre parcours cohérent malgré les détours
- Étape 1 : Identifier les éléments clés qui relient vos expériences.
- Étape 2 : Expliquer les raisons des changements de parcours avec honnêteté.
- Étape 3 : Valoriser les compétences nouvelles acquises à chaque étape.
- Étape 4 : Construire un discours clair et logique pour l’entretien.
- Étape 5 : Préparer des exemples concrets illustrant votre adaptabilité.
Pour mettre en pratique ces conseils, l’étape suivante consiste à obtenir une analyse personnalisée de votre situation et à commencer à construire activement le récit unique qui vous ouvrira les portes de la Grande École que vous visez.
Questions fréquentes sur les admissions parallèles en Grande École
Quelle est la différence entre Passerelle et Tremplin ?
Passerelle et Tremplin sont deux banques d’épreuves distinctes permettant d’accéder à différentes écoles de commerce. Bien que les deux s’adressent aux étudiants en admission sur titre, les conditions d’accès, les écoles membres du concours et parfois les épreuves peuvent légèrement varier pour s’adapter à divers profils.
Peut-on choisir plusieurs concours pour maximiser ses chances ?
Oui, il est non seulement possible mais aussi courant de candidater à plusieurs concours parallèles (par exemple, un concours commun comme Passerelle et un concours propre à une école) afin d’augmenter significativement ses chances d’admission dans un établissement.
Quels profils sont les mieux adaptés à ces concours ?
Ces concours sont principalement destinés aux étudiants titulaires d’un BTS, BUT (anciennement DUT), d’une Licence ou d’une Licence Professionnelle. Le choix du concours le plus adapté dépend de l’alignement entre le parcours académique antérieur du candidat, son projet professionnel et les spécialisations des écoles visées.